En Suisse, la « paix du travail » contribue au règlement des conflits du travail selon des procédures conventionnelles. Le fameux consensus propre au système helvétique débouche sur un taux de conflictualité parmi les plus bas du monde industrialisé.
A l’aube de la révolution industrielle, les grèves étaient encore de simples mouvements de protestation et de revendication locaux que seule la mauvaise condition des ouvriers légitimait. Aux mouvements spontanés du début sont venus s’ajouter les conflits sectoriels et corporatifs, bientôt coordonnés par le mouvement syndical, puis la grève générale, qui trouvera une première application concrète dans les manifestations du 1er mai 1886 aux Etats-Unis. En Suisse, la grève générale de novembre 1918 marquera durablement les esprits.
Marx et Engels confèrent aux grèves une fonction précise : celle de contribuer à forger la conscience de classe : « Elles sont l’école de guerre des ouvriers, où ils se préparent au grand combat désormais inéluctable ; elles sont les pronunciamientos de différentes branches de travail, consacrant leur adhésion au grand mouvement ouvrier » (Friedrich Engels,La situation de la classe laborieuse en Angleterre(1845), Paris, Editions sociales, 1960, version électronique, p. 181). Lénine, dansQue faire ?, oppose à une pratique « économiste » des syndicats anglo-saxons la pratique révolutionnaire, qui « subordonne la lutte pour les réformes, comme la partie au tout, à la lutte révolutionnaire pour la liberté et le socialisme » (Cité par G. Caire in :Dictionnaire critique du marxisme, Paris, PUF, 1982, p. 404).
Un « phénomène de guerre »
La doctrine sociale de l’Eglise, élaborée en réaction au libéralisme sauvage et au marxisme, tient la grève pour « moralement inacceptable lorsqu’elle s’accompagne de violences ou encore si on lui assigne des objectifs non directement liés aux conditions de travail ou contraires au bien commun » (Catéchisme de l’Eglise catholique, Paris, Mame/Plon, 1992, p. 494). Mais peut-il y avoir grève sans violence ? Georges Sorel n’y croit pas. Le théoricien du syndicalisme révolutionnaire se refuse à voir dans la grève « quelque chose d’analogue à une rupture temporaire de relations commerciales qui se produirait entre un épicier et son fournisseur de pruneaux, parce qu’ils ne pourraient s’entendre sur les prix » (Georges Sorel,Réflexions sur la violence(1908), Paris, Librairie Marcel Rivière, 1946, pp. 433-434). Dans sesRéflexions sur la violence, il présente la grève comme un « phénomène de guerre » et qualifie de « gros mensonge » l’affirmation que la violence serait un accident appelé à disparaître des grèves.

Le fait est que, utilisée en dernier ressort ou non, une cessation ou une désorganisation concertée et collective du travail - la définition moderne de la grève - est toujours un coup de force. Il en va de même du lock-out, qui constitue le plus souvent une réponse patronale à une grève.
Grève-émeute, grève politique, grève sur le tas, grève avec occupation, avec piquet, avec séquestration, grève tournante ou par roulements, grèves articulées, grève larvée, grève-bouchon ou grève-thrombose, grève du zèle, sans oublier le débrayage, la grève d’avertissement et la grève-surprise, cet acte de force revêt les formes les plus variées (Pascale Gazareth,Aspects de la grève et facteurs de sa rareté en Suisse, Mémoire de licence, Université de Neuchâtel, 1994, pp. 13-29). Dans la plupart des cas, il s’agit d’obtenir une désorganisation maximum de la production à un coût minimum pour les grévistes.
Le coup de force commence avec la formation, au sein d’une entreprise, d’un pouvoir autre que celui de la direction et qui prétend avoir autorité sur l’ensemble du personnel. La partie du personnel qui se prononce contre la grève reste libre, en théorie, de ne pas suivre le mouvement. Dans la pratique, sa liberté prend fin où commence l’action des piquets de grève. Les grévistes exercent une contrainte morale, et souvent physique, à l’égard des « jaunes » et de l’éventuelle main-d’œuvre de remplacement. Les pertes croissantes infligées à l’employeur pour le contraindre à négocier peuvent aller jusqu’à la détérioration de l’appareil de production, à l’absorption de l’entreprise par un concurrent, à son appropriation ou même sa destruction. Le chômage technique provoqué en amont et en aval de la production cause des dommages à des tiers : fournisseurs, clients, sous-traitants de l’entreprise touchée. On ne saurait oublier les contraintes exercées à l’encontre des usagers des services publics lorsque la grève y sévit. A chaque fois, et c’est encore vrai pour le lock-out, il y a perte pour l’ensemble de l’économie nationale.
Une pratique étrangère à l’éthique suisse du travail
Cette pratique du coup de force est étrangère, en Suisse, à la culture des relations de travail comme à l’éthique du travail. On le doit en grande partie à la paix du travail instaurée en 1937 et dont on fête cette année le 70e anniversaire.
Les conventions de l’horlogerie et de l’industrie des machines, conclues respectivement le 15 mai et le 19 juillet 1937, se bornaient à instituer l’arbitrage de certains conflits d’intérêts, en échange de la paix absolue du travail, imposant l’obligation de s’abstenir de tout moyen de combat, tels que grève ou lock-out, pour tout litige que ce soit. Les conditions de travail proprement dites restaient à négocier au sein des entreprises.
Gabriel Aubert, dans ses travaux consacrés à la paix du travail, fait remonter celle-ci non pas aux accords de 1937, mais au début des années 50, après les nombreuses grèves de la période 1945-1947. Ce n’est, il est vrai, qu’à partir de 1950 qu’on enregistre (à quelques exceptions près) moins de dix grèves par an. Le nombre des conventions collectives avec avenants s’inscrit, parallèlement, en forte augmentation, passant de quelque 400 en 1937 à 1’500 en 1955.
Paix relative et paix absolue
Le compromis, depuis cette époque, l’emporte sur l’affrontement, grâce à une clause de paix qui s’impose progressivement dans les conventions collectives. Encore faut-il observer que l’obligation de paix n’est pas toujours illimitée.
Depuis 1957, le Code des obligations distingue la paix relative et la paix absolue du travail. L’art. 323bis disposait au chiffre 2 :
« Chaque partie doit maintenir la paix du travail et s’abstenir en particulier de tout moyen de combat quand aux matières réglées dans la convention. L’obligation de maintenir la paix n’est absolue que si les parties en sont convenues expressément ».
Cet article, devenu l’art. 357a du Code des obligations, a été légèrement modifié dans la version révisée de 1972. Il indique que :
« Chaque partie maintient la paix du travail et, en particulier, s’abstient de tout moyen de combat quant aux matières réglées dans la convention ; l’obligation de maintenir la paix n’est illimitée que si les parties en sont convenues expressément »

Dans les années 70, les partenaires sociaux ont entretenu une vive controverse sur l’étendue de cette obligation. Ainsi, en 1971, le président du syndicat du bâtiment et du bois se déclara opposé à l’obligation de paix absolue au motif, notamment, que cette dernière plaçait les membres des syndicats en position d’infériorité par rapport aux travailleurs non syndiqués. Deux ans plus tard, ce même syndicaliste, devenu président de l’Union syndicale suisse, qualifia l’obligation de paix illimitée de « chèque en blanc ». Puis, en 1976, il déplora que l’obligation absolue interdise les actions de solidarité sur le plan international si bien que les travailleurs suisses risquaient de passer pour des briseurs de grève (Gabriel Aubert,L’obligation de paix du travail-Etude de droit suisse et comparé, Genève, Georg, 1981, p. 230)..
En 1977, 67 % des conventions avec clause de paix visaient la paix absolue, 4% la paix relative expressément mentionnée, les autres étant muettes à cet égard (ce qui revenait au même) (Ibid., p. 214). Les proportions relevées en 1977 ne semblent pas avoir été modifiées de façon significative depuis, même si on note une légère tendance à l’abandon de la clause de paix visant la paix absolue.
Il n’est pas surprenant que les critiques envers l’obligation de paix absolue soient venues du syndicat du bâtiment et du bois : en effet, la convention nationale, dans cette branche, liait à l’obligation de paix absolue l’arbitrage des seuls conflits collectifs juridiques : « Désireux d’y inscrire l’arbitrage des conflits d’intérêts (comme dans l’horlogerie et, partiellement, dans l’industrie des machines), le syndicat voulait que les employeurs acceptent l’arbitrage illimité, qui devait justifier le caractère absolu de l’obligation de paix » (Aubert,op. cit., p. 230).
Les milieux patronaux ont réagi avec vigueur à la mise en question de l’obligation illimitée : la disparition de la paix absolue équivaudrait, ont-ils souligné, à la disparition de la paix tout court. Du coup, faisant le bilan d’un demi-siècle de paix du travail dans le journalLe Monde, la syndicaliste Ruth Dreifuss croyait pouvoir qualifier celle-ci d’« idéologie ». Son collègue Vasco Pedrina, alors secrétaire central de la FOBB, enfonçait le clou : « A chaque renouvellement[d’une convention collective],on a voulu supprimer la paix du travail absolue. Les patrons y tiennent dur comme fer pour des raisons idéologiques ». Ce syndicaliste se disait alors prêt à « faire la grève générale en Suisse », tout en convenant que les travailleurs n’étaient pas disposés à le suivre. Le fait est que 67 % des personnes interrogées par sondage en 1989 jugeaient la paix du travail positive. L’appréciation des personnes syndiquées reflétait un taux de satisfaction analogue. Plus réaliste que ne l’étaient Mme Dreifuss et M. Pedrina à l’époque, le conseiller fédéral Moritz Leuenberger saluait récemment la Convention collective de travail pour le personnel des Chemins de fer fédéraux comme « une garantie face aux changements structurels » et en profitait pour qualifier la paix du travail d’« élément important du service public » (Dépêche de l’ATS du 19 décembre 2006).
Où le réalisme l’emporte sur l’idéologie de la lutte des classes
Fruit d’un dialogue permanent et non d’un acquis social, la paix du travail permet aux partenaires sociaux de préserver leur autonomie vis-à-vis de l’Etat et de régler pacifiquement des conflits selon des procédures conventionnelles. C’est le triomphe du réalisme sur l’idéologie de la lutte des classes. Prorogée aussi longtemps que chaque partie y trouve son intérêt bien pesé, la paix du travail n’a aucun caractère automatique ; elle exige non seulement la bonne foi des partenaires et l’art du compromis, mais d’abord la volonté de se réunir autour d’un tapis vert ; volonté qui s’affirme en fonction d’intérêts concrets à faire valoir.
De façon générale, et nonobstant les critiques envers l’obligation de paix absolue, les instruments développés depuis 1937 ont permis de régler pacifiquement une grande partie des conflits de travail, tant en période de haute conjoncture qu’en période de récession.
Le 1er mai 2005 (Office fédéral de la statistique,Enquête sur les conventions collectives de travail en Suisse 2005), on comptait 611 conventions collectives de base, par quoi il faut entendre des conventions collectives qui ne dépendent pas d’autres CCT et dont peuvent dépendre d’autres conventions. 1,5 million de salariés, sur un peu plus de 3,8 millions au total, étaient assujettis à ces conventions. L’édifice conventionnel (412 CCT d’entreprises et 199 CCT d’associations) couvrait ainsi environ 40 % des salariés.
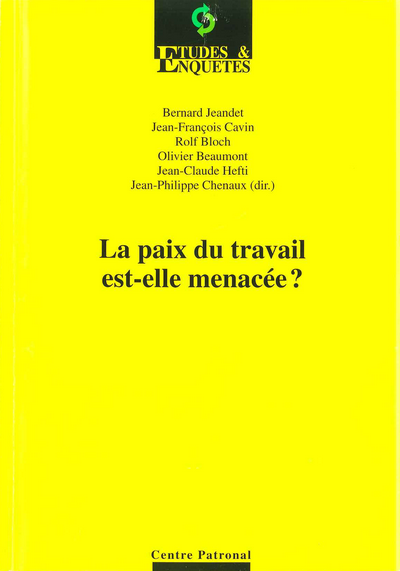
Grâce à la procédure graduelle de conciliation, plus des trois quarts des conflits ont trouvé une solution dans le cadre de l’entreprise, à la faveur de négociations directes entre les intéressés. Les organes de conciliation, certaines années, n’ont été que très peu sollicités. Ainsi, 34 procédures de conciliation ou d’arbitrage ont été introduites en 2005 (dont 13 dans le canton de Vaud et 8 à Genève), contre 18 en 2004. 31 conflits collectifs (16 l’année précédente) ont pu être réglés : 3 par sentence arbitrale de l’office, les autres à parts égales par arrangement direct entre les parties en cours d’instance et par acceptation de la proposition de l’office. Trois conflits collectifs n’ont pas pu être réglés : un en raison du rejet de la proposition de conciliation par les employeurs, un autre à cause du refus d’accepter un arbitrage par les employeurs, le troisième du fait de la rupture de pourparlers présumés vains par les travailleurs. 351 entreprises (14 en 2004) occupant 18’707 travailleurs (4’745 l’année précédente) étaient impliquées dans ces conflits collectifs. Le travail a été interrompu dans huit cas (1 seul en 2004) par un conflit ayant entraîné une grève.
Conflictualité infime en comparaison européenne
La Suisse n’a connu que vingt-cinq grèves entre 1987 et 1996 et une cinquantaine au cours de la dernière décennie. Le nombre annuel moyen de journées de travail ainsi perdues s’est élevé à 0,74 pour mille travailleurs pendant la première décennie susmentionnée. Même s’il est aujourd’hui très légèrement en hausse, cet indicateur de la conflictualité demeure, en Suisse, très inférieur à la moyenne européenne. Celle-ci se situe pour la période 1998-2004 à 43 journées individuelles non travaillées pour mille salariés (Ce classement compile les données de deux sources (Robert Lecou,Rapport d’information sur le service minimum dans les services publics en Europe, Paris, Assemblée nationale, 4 décembre 2003, et Mark Carley,Evolution de la situation en matière d’actions syndicales, 2000-2004, Observatoire européen des relations industrielles, 2005). Voir aussi le site Internetwww.acrimed.org/article2415).
Equilibre fragile
La paix du travail, on a pu le constater encore récemment lors du coup de force illicite de Comedia contre les Presses Centrales, à Lausanne (2001), et dans le conflit de Filtrona, à Crissier (2004), est éminemment fragile. Lors des deux grèves chez Boillat Swissmetal, à Reconvilier (2004 et 2006), on a assisté, de part et d’autre, à une escalade de la violence verbale, mais aussi des mesures d’intimidation et de rétorsion. De nouvelles formes de lutte, y compris le recours à des blogs, ont été inventées à cette occasion. D’autres pourraient voir le jour prochainement.
(Texte publié avec l’aimable autorisation de « Etudes et Enquêtes » n°36, Centre patronal, 2007, Lausanne, Suisse).
_edited.png)
Comments